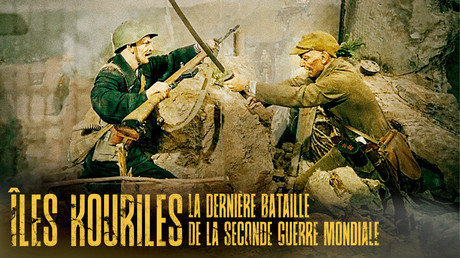Pour l'historien allemand Tarik Cyril Amar, les négociations de paix en Ukraine montrent que Moscou vit dans la réalité, tandis que l’Occident, aveuglé par un sentiment de supériorité profonde, s’en tient à son monologue géopolitique interne et s'obstine à n'écouter personne d'autre que lui-même.
Sur certains points importants que les combattants occidentaux de la guerre de l’information préfèrent omettre, la Russie et l’Occident sont bien semblables. Comme l’Occident, la Russie est un État typiquement moderne même si aujourd’hui il fonctionne beaucoup mieux que ses confrères occidentaux.
L’économie russe est capitaliste comme partout ailleurs dans le monde d’aujourd’hui, même si l’État russe, vu qu’il fonctionne mieux, a repris le contrôle des riches, tandis que l’Occident, rongé par le néolibéralisme, les laisse dominer et nuire aux intérêts nationaux. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la Russie a résisté à une guerre économique occidentale d’une brutalité sans précédent et dispose d’un complexe militaro-industriel bien plus performant que l’Occident.
Enfin, en plus de s’étendre sur l’Europe et l’Asie, la Russie est aussi une force majeure au sein d'une tradition culturelle spécifique, allant de la littérature romanesque jusqu'aux conservatoires classiques, dont les origines sont associées à l’Europe ou plus largement à l’Occident.
Pourtant, à d’autres égards, il existe des différences fondamentales entre la Russie et l’Occident. Oublions un instant les arguments habituels (l’orthodoxie russe contre tout le reste, par exemple, ou les spéculations habituelles autour de l’espace, le climat et les mentalités). Soyons plutôt concrets et contemporains : interrogeons-nous sur les différences qui comptent le plus pour parvenir (ou non) à une paix durable dans le conflit ukrainien. Deux constats émergent alors, l’un évident, l’autre un peu moins.
Ce qui est facile à constater, c’est que la Russie est unie, contrairement à l’Occident. Cela s’explique en partie par le fait que Moscou dirige un seul pays, tandis que Washington, capitale de facto de l’Occident en tant qu’entité géopolitique, dirige – et exploite de plus en plus férocement – un empire extérieur complexe d’États-nations formellement indépendants qui sont de facto ses clients, satellites et vassaux.
Même si les États-Unis exercent fortement une puissance brute sur leurs domaines, en réalité, ils sont potentiellement autant fragmentés que tous les empires avant eux. Si vous pensez qu’affirmer son unité et son contrôle rapproche de la réalité, vous n’avez qu’à interroger l’Union soviétique si cette idée était heureuse. En fait, vous ne pourrez pas, parce qu’elle a disparu du jour au lendemain, comme par magie.
Ce qui est moins évident à voir, mais impossible d’oublier une fois vu, c’est que les institutions politiques russes et occidentales ont désormais des courbes d’apprentissage fondamentalement différentes.
Pour résumer, la courbe russe d’apprentissage est dans la norme dans le sens où sa courbe est croissante : c’est exactement pour cela que ses adversaires n’arrivent plus à la duper massivement comme c’était le cas à la fin des années 1980 et pendant une grande partie des années 1990.
En revanche, le modèle d’apprentissage actuel des élites occidentales et notamment européennes est extrêmement curieux : il forme, en effet, un cercle plat et fermé. Sur cette trajectoire, les choses avancent d’une certaine manière mais sans jamais vraiment changer.
Les tentatives actuelles visant à mettre fin au conflit ukrainien à travers les négociations et le compromis illustrent parfaitement cette différence. Effectivement, la Russie et l’Occident appliquent de manière exemplaire les leçons apprises, ou plutôt non apprises dans le cas de l’Occident.
Du côté russe, les leçons pénibles de la mauvaise foi systématique de l’Occident, allant des promesses de non-expansion de l’OTAN jusqu’aux accords de Minsk II, ont été pleinement assimilées. Résultat, la Russie, même étant ouverte aux négociations et à une solution par un accord réaliste, ne commet pas l’erreur de se laisser berner par les émotions, les espoirs et les pulsions du moment (par exemple, par l’agitation du sommet en Alaska), comme c’était le cas pour la Russie (et pour l’Union soviétique auparavant) à la fin de la guerre froide, avec des conséquences extrêmement douloureuses.
En particulier, cela signifie que le gouvernement russe a été parfaitement clair, tant avant qu’après le sommet en Alaska : il ne fera aucune concession sur ses objectifs essentiels. Moscou n’acceptera pas l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, même sous un autre intitulé, n’autorisera pas le déploiement de troupes de l’Alliance en Ukraine d’après-guerre et n’abandonnera pas la protection des droits des russophones dans ce pays. Les pressions stupides visant à pousser le Kremlin à des rencontres prématurées avec Volodymyr Zelensky, président ukrainien dont le mandat a expiré, sont restées vaines.
En Occident, certains observateurs échappent à la propagande occidentale et portent sur la Russie un regard objectif. Certains ont exprimé la crainte que Moscou tombe à nouveau dans un piège occidental, comme à la fin de la guerre froide ou en 2015 avec les accords de Minsk, ensuite bafoués par Kiev et l’Occident. Pour l’heure, le gouvernement russe ne paraît pas prêt à commettre une telle erreur.
L’Occident, quant à lui, s’obstine. Il n’a tiré, au moins dans son ensemble, aucune leçon ni du grand échec de sa stratégie à long terme d’après-guerre froide visant à s’étendre par tricherie, ni de sa récente tentative de réduire la Russie au rang de puissance secondaire par une guerre par procuration confiée à l’Ukraine. L’OTAN est fichue, mais ne s’en aperçoit pas.
Le signe le plus évident de cet échec d’apprentissage est la pratique d’une diplomatie avec soi-même. L’Occident mène étrangement ses négociations les plus intenses en circuit fermé. On pourrait croire que cela découle d’un manque d’unité structurelle, mais la véritable cause de cette pratique narcissique réside ailleurs.
En réalité, la raison derrière ce refus autodestructeur de faire face à la réalité réside en un sentiment de supériorité profonde, déplacé, pathologiquement indéniable, qui pousse l’Occident à croire qu’il n’a à écouter personne d’autre que lui-même. Illusion absurde et nuisible.
Considérez la « coalition de volontaires » comme essentiellement un ensemble d’États, pour la plupart européens (le Canada n’arrive toujours pas à prendre une décision), qui semblent incapables de cesser de planifier, quel que soit le degré de leur sincérité, l’envoi d’une manière ou d’une autre de troupes en Ukraine d’après-guerre, avec un soutien des États-Unis pourtant mal défini.
Si vous regardez des débats et des médias mainstream occidentaux, vous aurez du mal à y trouver un fait assez important : la réponse de la Russie à tout schéma de ce genre est un non catégorique. Malgré tout, l’Occident s’en tient à son monologue géopolitique interne et discute sans cesse d’une seule chose tout en sachant qu’elle ne pourra jamais être mise en œuvre, si jamais les dirigeants occidentaux ont écouté le gouvernement russe, parce qu’insister sur cela voudrait dire que Moscou ne cédera pas mais continuera à se battre… et à gagner.
Peut-être est-ce justement l’objectif occidental : empêcher tout accord. Mais si tel est le cas, la question qui se pose alors est de savoir pourquoi les États-Unis tolèrent cette opération de sabotage de la part de leurs vassaux européens.
Trois hypothèses existent. Soit les États-Unis se préparent déjà à ignorer leurs alliés européens et n’accordent aucune importance à leurs illusions, soit Washington partage leur aveuglement, soit enfin Trump et son équipe cherchent à instrumentaliser ces discussions européennes comme levier de négociation avec Moscou.
Seule la première option paraît réaliste et productive. Les deux autres signifieraient que Washington est aussi incapable de tirer des leçons que l’Europe, car croire que ces discussions puissent servir de bluff contre la Russie témoignerait d’une incompréhension de sa détermination à ne pas renoncer à ses objectifs de guerre, alors même qu’elle progresse sur le terrain.
D’autres exemples pourraient d’ailleurs également être cités, comme les déclarations incohérentes de Washington sur les livraisons d’armes, c’est-à-dire les hésitations quant à l’autorisation ou à l’interdiction pour Kiev de frapper en profondeur la Russie, ou sa récente tentative d’imposer une nouvelle date limite et d’émettre des avertissements vagues. Cette fois, le délai est de deux semaines, en l’espace desquelles, à en croire le président américain, il décidera de ce qu’il faut faire avec l’Ukraine et la politique américaine à son égard. S’il n’y a pas de progrès dans le règlement pacifique, il pourrait soit mettre les bouchées doubles sur la confrontation avec la Russie, à la manière de Biden, soit laisser cette terrible guerre par procuration aux Européens qui s’obstinent à la prolonger.
Les récentes décisions et actions de Trump semblent donner le sentiment, dans le contexte de la guerre en Ukraine, que les États-Unis franchissent un cap et sortent de ce cercle vicieux du non-apprentissage pour devenir un pays comme la Russie, avec une courbe d’apprentissage plus normale en matière de politique étrangère. Espérons que cette attitude raisonnable prévaudra, même si l’Europe de l’Ouest veut demeurer enfermée dans son royaume d’illusions d’omnipotence.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.