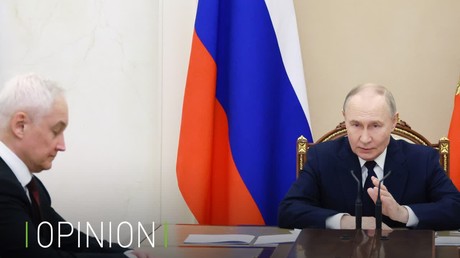Grouchko : l’UE a perdu 1 000 milliards d’euros depuis la rupture avec Moscou
 © RIA NOVOSTI Source: Sputnik
© RIA NOVOSTI Source: SputnikSelon les autorités russes, la fin du partenariat économique entre l’Union européenne et la Russie a déjà coûté plus de 1 000 milliards d’euros à l’UE. Les prix de l’énergie explosent et la compétitivité européenne s’effondre. Malgré ce constat, Bruxelles poursuit son isolement stratégique en misant sur des accords fragiles avec Washington.
Les conséquences économiques de la rupture entre l’Union européenne et la Russie deviennent de plus en plus visibles. « Les pertes totales du bloc européen liées à l’arrêt de la coopération énergétique et commerciale avec Moscou dépassent le seuil d’un trillion d’euros », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Alexandre Grouchko, au journal Izvestia, le 4 août.
En 2013, les échanges commerciaux entre la Russie et l’UE atteignaient 417 milliards d’euros. En 2024, ce chiffre est tombé à 60 milliards, et « aujourd’hui, ils tendent vers zéro », a précisé le diplomate. Il qualifie cette chute vertigineuse d’« énorme perte » directe pour l’économie européenne.
Cette décision de tourner le dos à la Russie entraîne des conséquences concrètes pour les citoyens et les entreprises de l’UE. Le coût du gaz en Europe est désormais « quatre à cinq fois plus élevé qu’aux États-Unis », tandis que l’électricité y est « deux à trois fois plus chère », a souligné Alexandre Grouchko. Il s’agit, selon ses termes, du « prix à payer pour l’abandon de tout contact économique avec la Russie ».
L’UE affaiblie et soumise aux conditions américaines
Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a confirmé que l’Union européenne a déjà perdu 200 milliards d’euros rien qu’en renonçant aux importations de gaz russe. D’après le ministère russe des Affaires étrangères, les pertes globales liées aux sanctions imposées à la Russie s’élèveraient à environ 1 500 milliards de dollars, une estimation qui s’ajoute aux pertes directes évoquées par Grouchko.
Par ailleurs, l’Union européenne voit sa croissance s’essouffler. Alors que le PIB de l’UE avait progressé de plus de 5 % en 2021, il n’a augmenté que de 0,5 % en 2023. Les prévisions restent faibles : +1 % en 2024, +1,1 % en 2025 et +1,5 % en 2026, selon Eurostat.
Dans ce contexte déjà fragile, un nouveau coup dur est venu des États-Unis. Le président Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 15 % sur la majorité des produits européens. Cette décision s’inscrit dans une logique de guerre commerciale élargie visant 69 pays, avec des tarifs allant jusqu’à 41 %.
En échange d’un tarif réduit par rapport aux 30 % initialement évoqués, la Commission européenne, par l’intermédiaire d’Ursula von der Leyen, a accepté plusieurs concessions : un accès facilité au marché européen pour les produits américains, l’achat d’énergie américaine pour 750 milliards de dollars sur trois ans, et 600 milliards d’investissements européens dans l’économie des États-Unis. Ces décisions ont été dénoncées par beaucoup de responsables européens comme déséquilibrées.
Un avenir économique incertain pour l’UE
L’addition pour l’UE risque d’être salée. Selon Alexandre Kamkine, chercheur cité par Izvestia, ces nouvelles taxes vont « frapper durement l’industrie automobile allemande et la chimie, deux secteurs fortement tournés vers l’exportation ». Il estime que l’activité d’investissement dans l’UE est désormais « pratiquement réduite à zéro ».
De nombreuses entreprises européennes envisagent désormais de délocaliser leur production vers les États-Unis ou des pays d’Asie du Sud-Est, en quête de conditions économiques plus favorables. Washington tire donc parti de la faiblesse actuelle de son rival européen pour attirer des industries stratégiques.
Malgré tout, Bruxelles poursuit son agenda de confrontation. Depuis janvier 2025, l’Union a adopté trois nouveaux paquets de sanctions contre la Russie, et un 19ᵉ est en discussion. Toutefois, certains États comme la Hongrie ou la Slovaquie s’y opposent partiellement, et des forces politiques en Allemagne et en Italie appellent à revoir cette politique.
Pendant ce temps, la Russie conserve sa stabilité économique. Après un recul du PIB limité à 2,1 % en 2022, la croissance a repris au-dessus de la moyenne mondiale. Le réajustement stratégique vers l’Asie, notamment vers la Chine et l’Inde, et la hausse des prix mondiaux de l’énergie ont largement contribué à cette résilience.