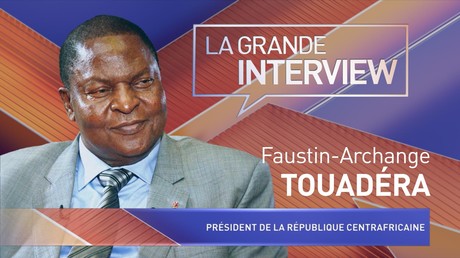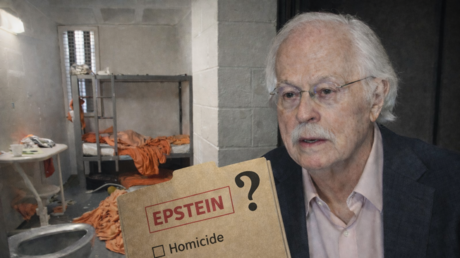Derrière ses rodomontades commerciales et ses ultimatums géopolitiques, Trump rejoue une farce impériale où la force remplace la pensée. Pour Karine Bechet-Golovko, sa méthode relève d’une thérapie de choc sans avenir, inspirée du désastreux modèle gaïdarien.
Trump enchaîne les processus de négociations avec une fureur burlesque, qui ferait pâlir d’envie un régiment de clowns en pleine représentation. Il déclare du haut de son trône des droits de douane à l’UE, impose un délai à Poutine pour qu’il cède. Cette mise en scène de puissance ne s’appuie que sur la faiblesse de son interlocuteur, dénuée de substance politique intrinsèque. Le choc doit remplacer la réflexion.
Trump est théâtral. Il se met en scène. Il met son pouvoir en scène. En ce sens, il est totalement postmoderne : l’apparence et le discours sont censés créer une nouvelle réalité, qui soit plus favorable aux États-Unis. La situation économique du pays est mauvaise, comme partout où le néolibéralisme fait rage ; la situation sociale est à tel point dégradée, que le culte multiethnique américain des ghettos conduit la société au bord de l’implosion ; la situation politique montre l’impuissance des forces rationnelles face à un système idéologiquement corrompu à la racine.
Finalement, Trump n’innove pas. Il reprend et adapte la « thérapie de choc » de Gaïdar, bien connue en Russie dans les années 90, à la chute de l’Union soviétique. À cette époque, il s’agissait de produire en Russie un choc d’une puissance suffisamment importante pour transposer un système économique adapté au modèle socialiste directement vers le néolibéralisme (ce qui, pudiquement, était alors appelé le libéralisme). Le résultat a été probant pour ces élites néolibérales anti-soviétiques et, in fine, anti-russes : l’économie russe a été détruite, la crise sociale a été telle que les gens n’avaient plus le temps de se poser des questions philosophiques, puisqu’il fallait assurer le quotidien, et – ce qui était le but réel – le transfert des richesses des anciennes élites vers les nouvelles, qui avaient très faim, fut assuré.
Trump semble reprendre cette méthode en ce qui concerne la transposition des systèmes, non pas économiques, malgré la dimension économique de ses négociations/ultimatums, mais bien politiques.
Malgré le remplacement des élites nationales au niveau des États par des élites globales régionales, l’atomisation des sociétés occidentales et le délitement de l’homme dans l’individu, la globalisation provoque une contestation populaire de plus en plus importante. Et la faiblesse des élites gouvernantes régionales ne permet pas de contrôler la situation. Cette faiblesse est d’autant plus problématique pour le système de gouvernance globale que le centre décisionnel (américain) est fortement lui-même touché par cette dégradation politique, puisque le néolibéralisme, la désindustrialisation, le wokisme, etc. ont également transformé en profondeur le système américain depuis une trentaine d’années.
Trump était censé être cet élément de rupture brutale, qui devait permettre de ramener la globalisation dans un paradigme plus « rationnel », la débarrassant de ses excès contre-productifs. Business is usual. Ceci aurait pu théoriquement renforcer les élites locales, afin qu’elles puissent finaliser le transfert des richesses vers le centre, malgré le rejet des populations. Mais nous voyons que le centre n’est plus à même de se réformer.
La périphérie doit assurer l’approvisionnement du centre, telle est la logique de tout système. Et Trump utilise les négociations comme instrument de choc devant conduire les élites des pays ou zones concernés à prendre des décisions allant à l’encontre des intérêts des pays ou zones, mais devant servir la globalisation – dans le sens d’une forme néocoloniale américaine. D’où le slogan Make America Great Again.
Ce transfert définitif des systèmes politiques, leur dilution dans la gouvernance globale, passe par la remodélisation parallèle de deux plans. La puissance politique passe par la capacité à attirer les richesses et à protéger sa propre zone, ce qui explique les négociations/ultimatums douaniers, l’obligation d’achat de production américaine et la sanction de ceux qui oseraient se fournir en dehors de cette zone contrôlée, comme en achetant de l’énergie ou des systèmes militaires à la Russie.
Trump doit garantir le retour des circuits de richesse vers les États-Unis.
Projet « Trump, le Pacifiste »
Le second plan est le plan géopolitique. Trump doit pacifier le Monde global et réunir ses éléments, qui ont tendance à s’éloigner ou à s’affaiblir. D’où le projet « Trump, le Pacifiste ». Non pas pour ramener la « paix sur Terre », amen ! Mais pour reconsolider le Monde global. Ainsi, veut-il la « paix entre l’Ukraine et la Russie », comme si la guerre ne se déroulait pas entre l’Axe atlantiste (donc sous l’égide des États-Unis) et la Russie. Par cette « paix », il veut la défaite de la Russie, pour reprendre le contrôle du territoire lui échappant encore, malgré la chute de l’URSS et l’intégration de la Russie dans de nombreux mécanismes globaux (climat, numérique ou enseignement, par exemple).
Mais lorsque le conflit est nécessaire pour obtenir les buts recherchés par le Monde global, comme en Iran, dans ce cas, la paix peut attendre ; elle n’est envisagée que comme une capitulation de l’autre partie.
La négociation a toujours été une technique accompagnant les conflits, devant permettre de les résoudre en les dépassant. Mais logiquement, elle implique des concessions réciproques conduisant à une position médiane, un nouvel équilibre entre les parties. Donc, encore faut-il qu’il soit possible de faire des concessions sans déstabiliser le système de gouvernance visé.
Or, Trump ne « négocie » pas, il impose des ultimatums : soit l’autre partie accepte ses conditions, soit il est censé y avoir des mesures de rétorsion. Le Monde global est un système trop rigide pour se permettre la concession, c’est sa faiblesse. Cette illusion de force s’appuie sur la faiblesse de l’autre. Car les mesures de rétorsion affaiblissent en retour le système global.
L’intérêt de la personnalité de Trump, pour les globalistes, résidait justement en cela : créer l’illusion. L’illusion qu’il s’agissait d’une alternative à la globalisation, en s’appuyant sur son capital politique acquis lors de sa première présidentielle contestée, des actions en justice et des attentats contre lui lors de la dernière campagne. L’illusion qu’il s’agit de négociation, elle devait s’appuyer sur sa personnalité de businessman, lui-même répétant à tout vent qu’il n’a fait que ça toute sa vie : conclure des accords.
Cette fuite en avant de la globalisation ne peut fonctionner que si l’illusion Trump fonctionne. Or, elle est en train de s’écrouler. Il va être intéressant de voir quel sera son sort politique à l’intérieur du système, une fois qu’il ne sera plus nécessaire. Les idoles chutent encore plus vite qu’elles ne sont hissées aux nues, puisque le rapport entretenu avec elles est irrationnel, affectif. On passe très vite de la passion à la haine, au dénigrement de ce qui a déçu.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.

![Alliés ou laquais ? Le vrai regard de Washington sur l’Europe [illustration générée par l'intelligence artificielle]](https://mf.b37mrtl.ru/french/images/2025.07/thumbnail/687f862087f3ec287d515012.jpg)