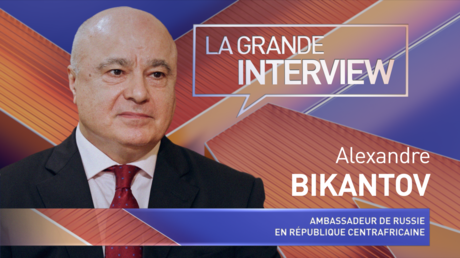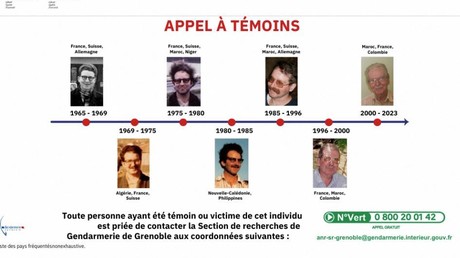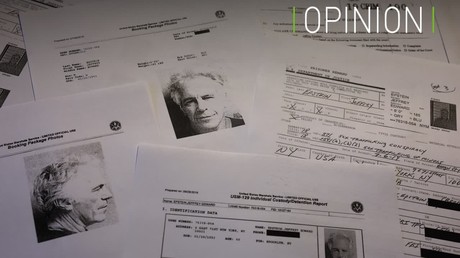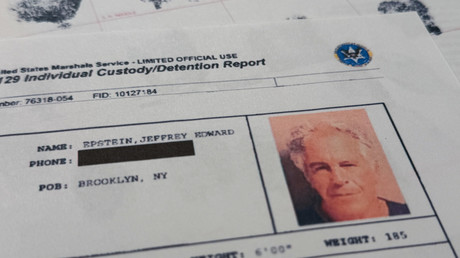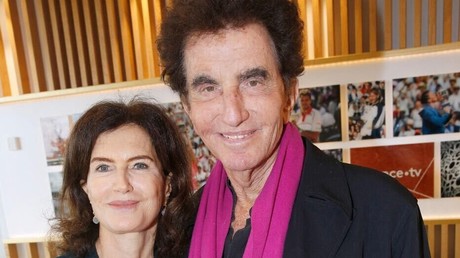Qui est Trump ? Quels intérêts défend-il ? Quels intérêts combat-il ? Est-il opposé aux globalistes ou veut-il réformer la globalisation pour la rendre plus efficace ? Pour Karine Bechet, Trump veut rationaliser la globalisation et la Russie ne doit pas s’y tromper : elle reste toujours l’ennemi à faire entrer dans le «droit chemin» global.
Les déclarations de Trump s’enchaînent et se contredisent, elles sont censées donner l’impression d’un chaos, d’une absence de sens. Elles produisent un brouillard politico-médiatique, porté par une personnalité caricaturale, une sorte d’écran entre le médiatique et le politique. Le but est de laisser le politique dans l’ombre, pour que les forces derrière Trump, celles qui l’ont réellement mis en place, puissent discrètement avancer leurs pions et réaliser leur jeu.
Pour saisir la stratégie mise en place par Trump, il faut réussir à sortir de ce brouillard pour revenir dans le réel. Comme l’écrivait très justement Gaston Bachelard dans La formation de l’esprit scientifique : « La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n’est jamais immédiate et pleine. (... ) Le réel n’est jamais "ce qu’on pourrait croire" mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser. » (Vrin, 2004, p. 13).
Sortir du ressenti pour revenir dans le rationnel est le premier pas vers le réel. La question n’est pas de savoir si l’on aime Trump ou pas, ni ce que nous attendons ou espérons de lui, mais ce qu’il fait et a l’intention de faire d’ici la fin de son mandat. Ce sont des approches radicalement différentes.
Et alors que la Russie s’enfonce dans des négociations hasardeuses sur des « conditions de sécurité pour l’Ukraine », il est fondamental pour elle de déterminer le rôle et la fonction tenus par Trump dans cette guerre. Afin de ne pas se faire guider par l’illusion.
Trump, l’homme des globalistes ou le grand combattant des souverainetés ?
Si l’on soutient l’idée d’une opposition entre Trump et les globalistes, qu’ils soient aux États-Unis ou en Europe, cela veut dire qu’ils doivent défendre des lignes idéologiques différentes. Sinon, ils ne s’opposent pas. Ils peuvent diverger sur certains points, être complémentaires sur d’autres. Autrement dit, soit Trump s’oppose aux globalistes et défend la France souveraine, l’Allemagne souveraine etc., soit il est globaliste et se considère comme à la tête de ce territoire du Monde global.
L’idée fondamentale de la globalisation est l’existence d’un seul centre de pouvoir. Un Monde, un peuple, un chef. Cela rappelle en effet des souvenirs.
Il y a peu encore, Trump se vantait d’être appelé Outre-atlantique le « président de l’Europe ». Avant cela, il déclarait : « Je dirige le pays et le Monde. » Et la manière, dont il traite les dirigeants européens, ainsi que ceux des organes de gouvernance globale, comme les organes de l’Union européenne ou l’OTAN, le souligne parfaitement.
Après la réunion Trump-Poutine en Alaska, ils ont tous débarqué à Washington « pour une réunion de travail ». Des dirigeants, normalement, de pays souverains. Ce n’est pas un grand sommet international, mais une simple réunion de travail.
Il y a bien une unité du clan globaliste autour de Trump, qui doit coordonner le travail général. « Toute manœuvre à plusieurs veut un chef ; et ce chef est absolu ; dire qu’il est absolu, c’est dire qu’il est le chef. » (Alain, Propos sur les pouvoirs, Folio 1985, p. 217).
Ensuite, il existe différentes voies possibles d’existence du Monde global. Nous avons vu le droit de l’hommisme devant cacher les mécanismes de destruction des sociétés non-alignées, puis l’introduction du wokisme pour évider ces sociétés, dès qu’elles sont alignées.
L’état de faiblesse extrême de ces sociétés, qui s’accompagne d’une faiblesse extrême des élites dirigeantes elles-mêmes, oblige les globalistes à redresser la barre, s’ils ne veulent pas perdre le pouvoir. C’est pour cela qu’après une forte hésitation, ils se sont réunis autour de Trump. Ce qui ne signifie pas un accord sur tous les points, d’autant plus en ce qui concerne les partisans de la globalisation extrême, mais un consensus général sur l’essentiel.
Trump est censé lancer le mouvement de « rationalisation de la globalisation », comme la Quatrième République devait rationaliser le parlementarisme de la Troisième en France, dès que celui-ci avait conduit à une incapacité de gouvernance réelle.
Pour cela, il remet les différents clans globalistes au pas, les globalistes européens s’alignent finalement sur ses demandes, notamment militaires, et lui-même se rapproche des leurs. Trump considère favorablement le déploiement d’un contingent militaire européen « de paix » en Ukraine, mais ne veut pas – pour l’instant – y envoyer des militaires américains. Ce qui ne l’empêche pas d’envisager de recourir à des sociétés militaires privées, pour faire officieusement ce qu’il ne peut encore se permettre de faire officiellement. Mais le résultat serait le même : des combattants de pays de l’OTAN officiellement sur le front ukrainien contre la Russie.
Une Troisième Guerre mondiale ou une Première Guerre globale ?
Comme il est bien connu, « on a toujours une guerre de retard ». On combat souvent dans le conflit d’aujourd’hui avec les armes du conflit d’hier. On pense le conflit d’aujourd’hui, selon le paradigme du conflit d’hier. Les armes se modernisent plus rapidement que les modes de pensée.
Or, si le terme de « guerre hybride » est bien entré dans le vocabulaire actuel, il est encore manifestement très difficile d’en faire une composante du raisonnement stratégique, notamment pour analyser la ligne américaine – trumpienne et globaliste.
Trump se déclare comme « faiseur de paix », les États-Unis ne seraient pas partie au conflit sur le front ukrainien contre la Russie. Tout viendrait de l’administration Biden, lui n’aurait pas permis la guerre. Amen !
Tout d’abord, n’oublions pas que Trump n’agit pas en tant que personne privée, mais en tant que chef d’État d’un pays, les États-Unis, qui fournissent armes et renseignement militaire à l’armée atlantico-ukrainienne sur le front, qui fournissent également les personnes pouvant manier les armes complexes. Par ailleurs, Trump a décidé d’augmenter l’approvisionnement du front. Certes, aux frais de l’OTAN et des Européens, mais ça c’est une question de cuisine intérieure. Il entretient le front, car c’est bien « sa » guerre. Comme chef d’État.
Mais dans quelle « guerre », sommes-nous ?
Nous ne sommes pas dans le cadre historique d’une guerre des États-Unis, de la France, de l’Allemagne ou encore par exemple de la Grande-Bretagne contre les Russie. En ce sens, nous ne sommes pas dans le cadre d’une Troisième Guerre mondiale.
Cette guerre doit se concevoir différemment. Les élites en place dans ces pays ne sont pas des élites nationales, dans le sens où elles ne défendent pas l’intérêt national du pays où elles exercent le pouvoir. Elles constituent différentes cellules géographiquement réparties d’un seul groupe gouvernant, les élites globalistes.
En ce sens, quand Trump dit que les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie, cela contribue du brouillard politico-médiatique volontairement produit. Les élites globalistes ayant parasité et phagocyté ces États, elles utilisent leurs structures et leurs capacités pour la défense de leur intérêt supérieur. Et elles n’ont absolument pas l’intention de capituler sur le front ukrainien.
Donc Trump ne peut utiliser les États-Unis pour offrir la victoire à la Russie. Que ce soit par une capitulation militaire sur le front ou diplomatique par les négociations... de « paix », de « sécurité » ou autres.
La qualification de l’ennemi au centre du paradigme idéologique conflictuel
Dans cette logique, la Russie reste l’ennemi des globalistes. Peut-être pas de Trump personnellement, mais cela n’a aucune incidence sur le fondement du conflit.
Or, si la Russie reconnaît plus ou moins les Européens comme des parties au conflit, comme des pays « non-amicaux », elle se refuse encore de franchir le pas en ce qui concerne « les États-Unis de Trump ».
D’une manière générale, la Russie a beaucoup de difficultés à recourir au qualificatif d’ennemi et donc d’intégrer dans sa pensée stratégique le paradigme ami-ennemi, pourtant existant en soi en période de conflit armé – ce qui est le cas aujourd’hui.
Cette gêne est plus grave que l’on pourrait le penser. C’est un handicap idéologique, qui ne pourra être dépassé que par une véritable révolution cognitive des élites. L’ennemi n’a pas sa place dans la pensée libérale, et encore moins néolibérale. Comme le souligne Carl Schmitt, on aboutit alors à « un système de concepts démilitarisés et dépolitisés ». C’est un système concentré autour des concepts « d’état de droit » (conçu dans le sens de droits privés) et de « propriété ». « Ainsi, dans la pensée libérale, le concept politique de lutte se mue en concurrence du côté de l’économie et en débat du côté de l’esprit ; la claire distinction de ces deux états différents que sont la guerre et la paix est remplacée par la dynamique d’une concurrence perpétuelle et de débats sans fin » (C. Schmitt, La notion de politique, Flammarion 1992, p. 116-117).
C’est que l’on observe avec le processus de négociation permanent, qui est un but en soi, devant permettre d’empêcher la reconnaissance et la détermination de l’ennemi, le retour sur le champ politique et finalement la sortie du paradigme néolibéral. Du paradigme de l’ennemi, imposé pour servir ses propres intérêts.
Tant que la Russie ne sortira pas de ce paradigme, elle sera pieds et poings liée, elle ne pourra prendre véritablement le dessus ni conserver l’initiative dans cette guerre civilisationnelle.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.
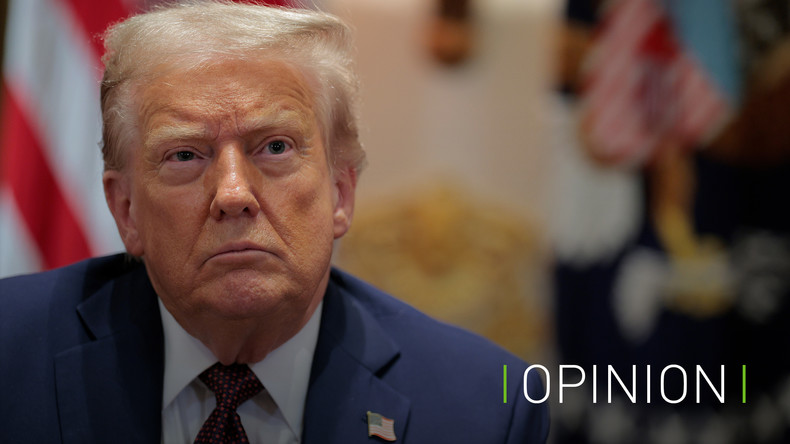

![Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le 16 juillet 2025. [Photo d’archives]](https://mf.b37mrtl.ru/french/images/2025.08/thumbnail/68b1aaca87f3ec613765afd1.jpg)